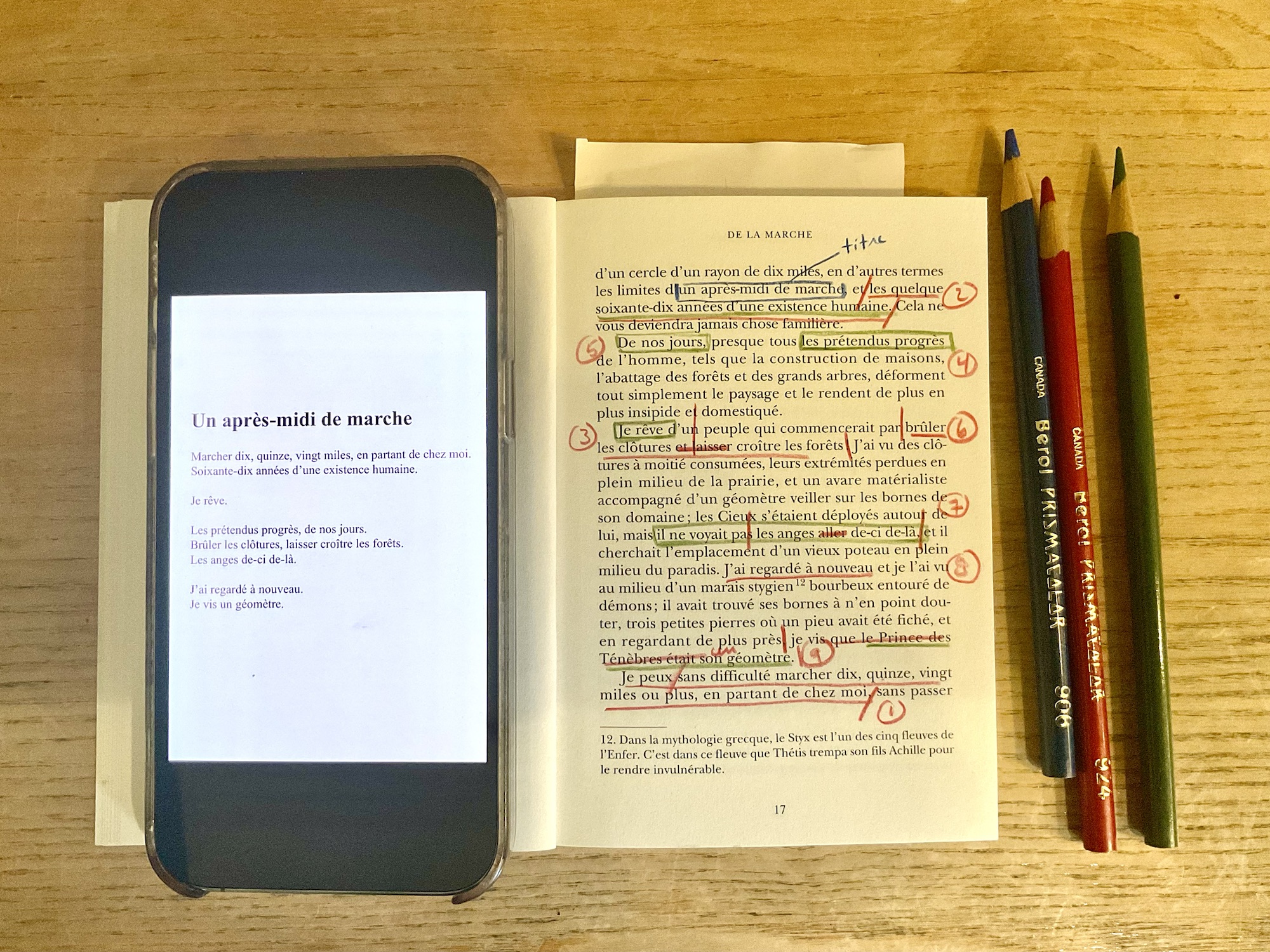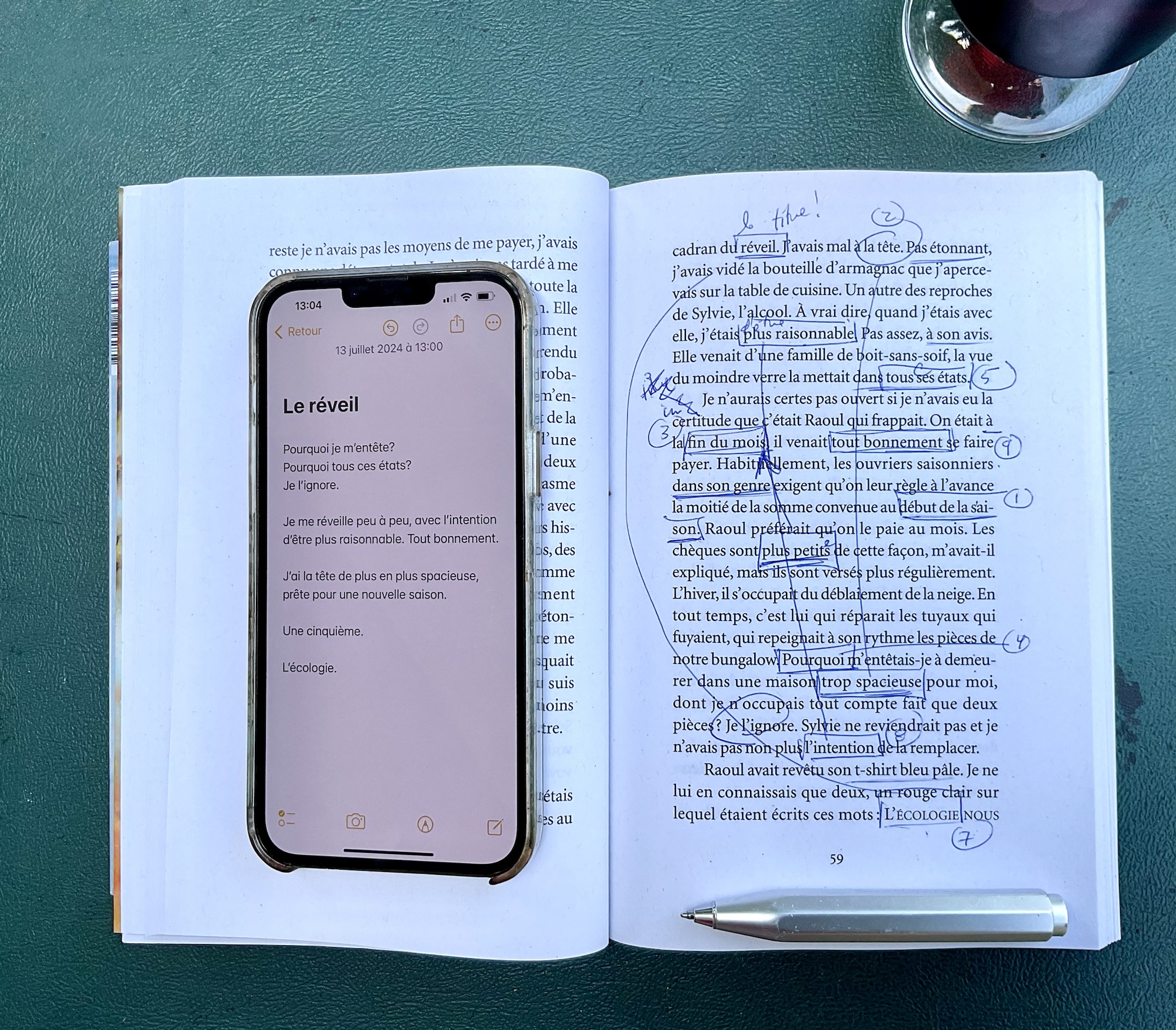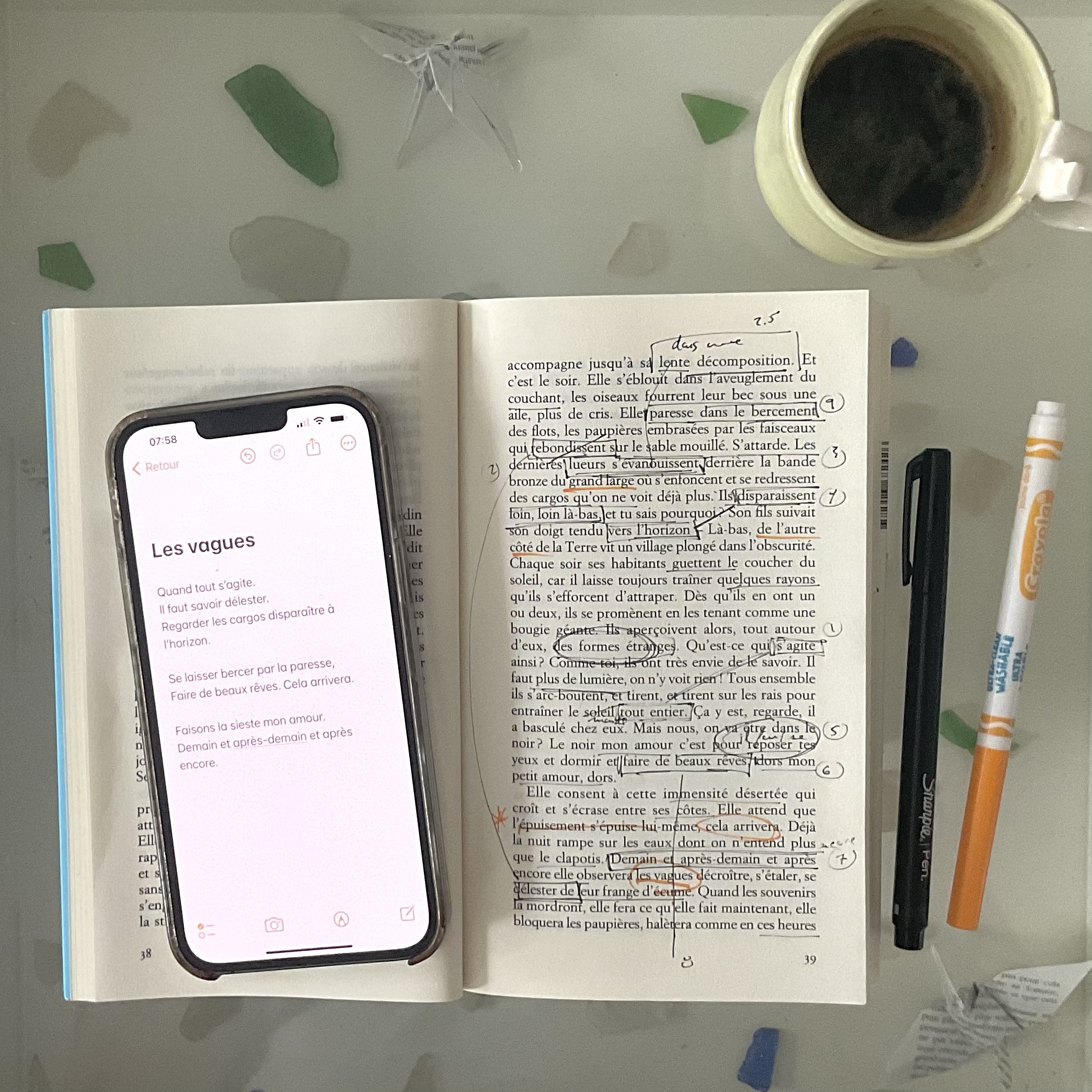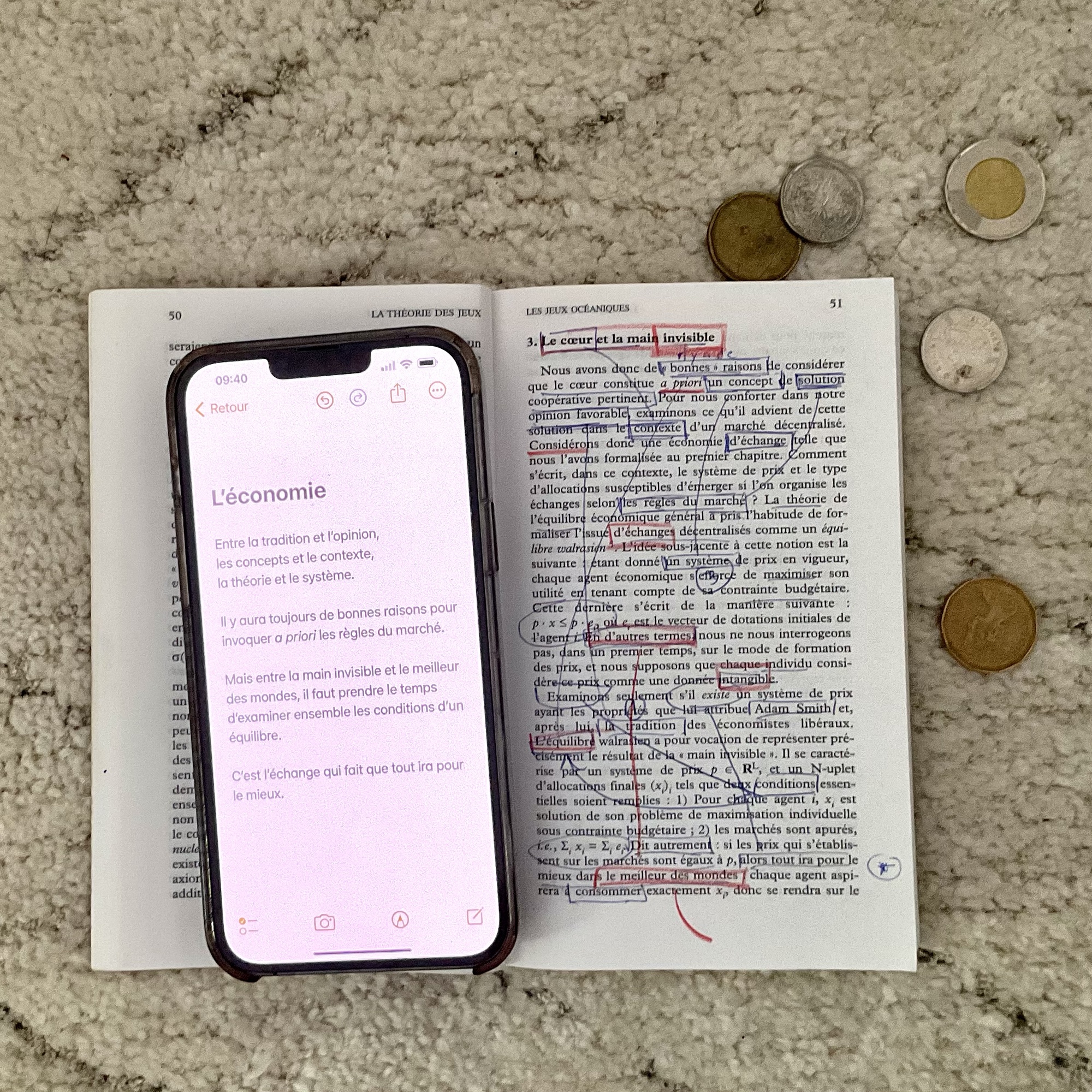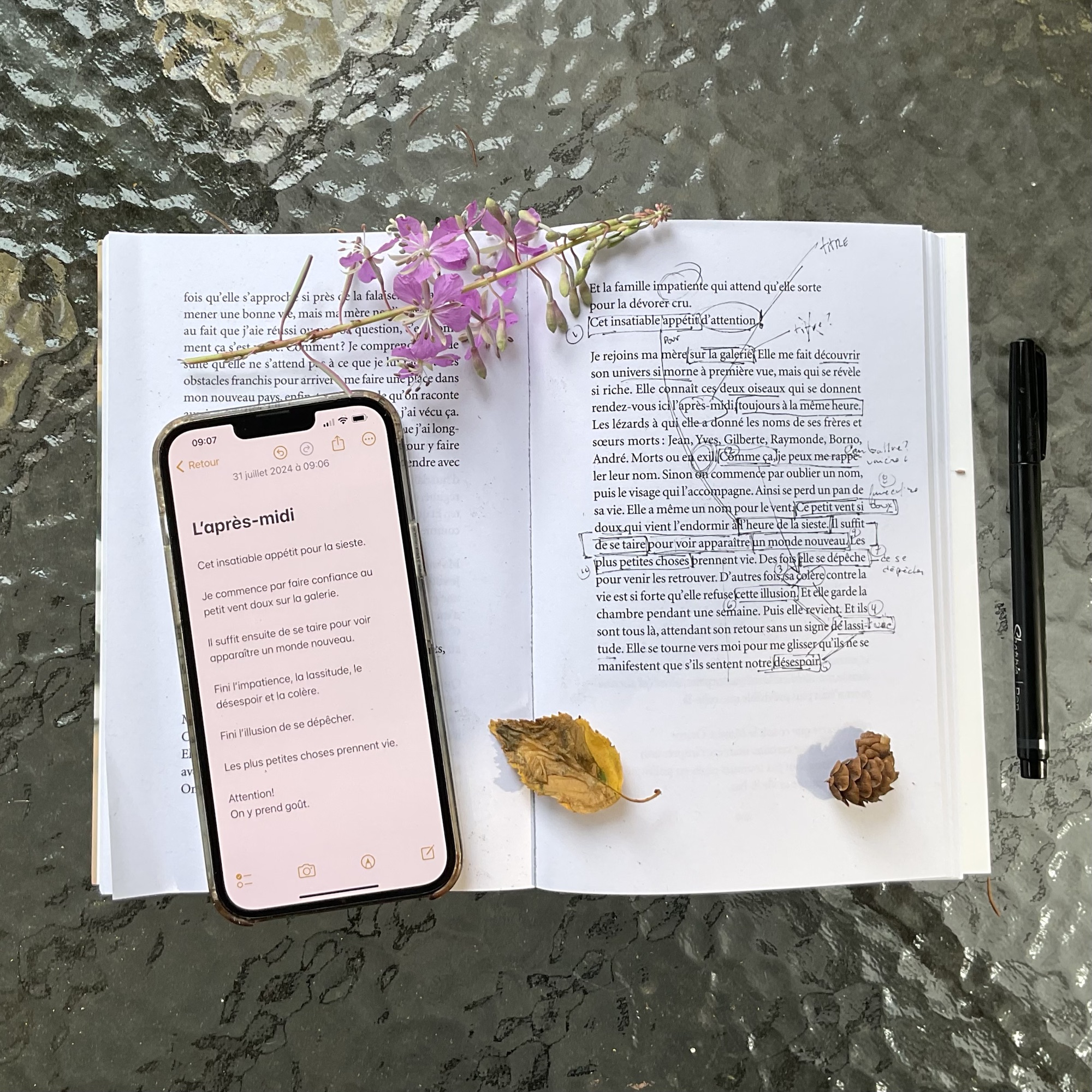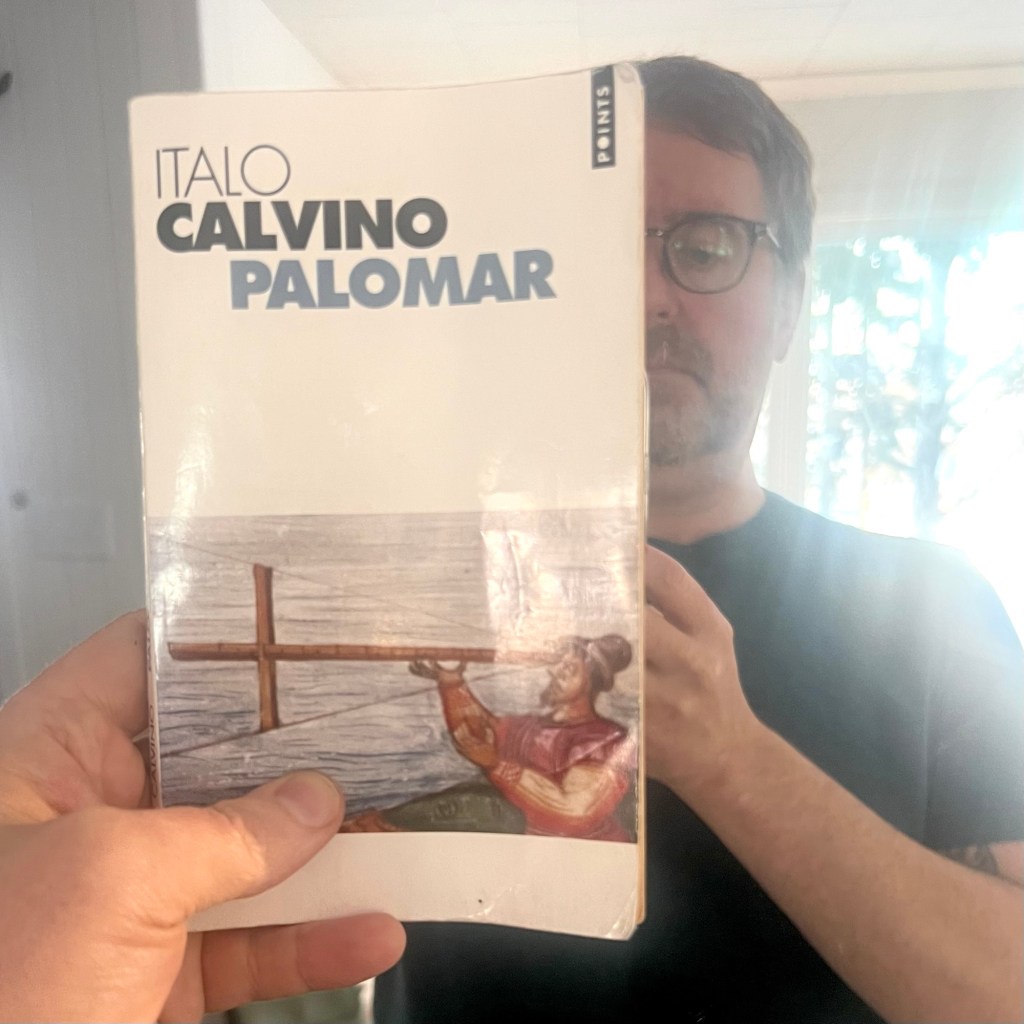Il y a quelques jours je me suis presque défait d’un petit livre qui ne me disait rien. C’est Ana qui, au dernier moment, m’a dit « ben voyons! Un livre de Jules Verne qui a pour titre Une fantaisie du docteur Ox… c’est tout toi ça… commence donc par le lire! ».
Ce que j’ai fait. Et je ne l’ai pas regretté! Je peux vous assurer que ce livre va retrouver sa place dans la bibliothèque.
Le livre raconte l’incroyable histoire de la petite ville de Quiquendone, que le docteur Ox a promis d’éclairer, entièrement à ses frais.
Est-ce que la ville de Quiquendone existe vraiment? Jules Verne nous l’assure:
« Si vous cherchez sur une carte des Flandres, ancienne ou moderne, la petite ville de Quiquendone, il est probable que vous ne l’y trouverez pas. Quiquendone est-elle donc une cité disparue? Non. Une ville à venir? Pas davantage. Elle existe, en dépit des géographes, et cela depuis huit à neuf cents ans. Elle compte même deux mille trois cent quatre-vingt-treize âmes, en admettant une âme par chaque habitant. (…)
Quiquendone existe bien réellement avec ses rues étroites, son enceinte fortifiée, ses maisons espagnoles, sa halle et son bourgmestre — à telle enseigne qu’elle a été récemment le théâtre de phénomènes surprenants, extraordinaires, invraisemblables autant que véridiques, et qui vont être fidèlement rapportés dans le présent récit. (…) »
Il s’agit d’une ville reconnue pour son calme, avec un maire tout à l’image de sa ville:
« Le bourgmestre était un personnage de cinquante ans, ni gras ni maigre, ni petit ni grand, ni vieux ni jeune, ni coloré ni pâle, ni gai ni triste, ni content ni ennuyé, ni énergique ni mou, ni fier ni humble, ni bon ni méchant, ni généreux ni avare, ni brave ni poltron, ni trop ni trop peu – ne quid nimis -, un homme modéré en tout. (…) Le bourgmestre Van Tricasse était le flegme personnifié. (…) »
Un maire qui avait néanmoins de l’ambition pour sa ville; ce qu’avait très bien compris le docteur Ox.
« Le progrès marche, et nous ne voulons pas rester en arrière! (…) Il faut bien marcher avec son siècle. Si l’expérience réussit, Quiquendone sera la première ville des Flandres éclairée au gaz oxy-hydrique. »
Je crois qu’il est utile de rappeler ici que le livre a été écrit en 1872, que l’ampoule électrique a été inventé en 1878, et que c’est seulement en 1884 — douze ans plus tard — qu’une première ville française a été électrifiée.
Ainsi donc, une usine est construite à Quiquendone et des tuyaux sont posés dans toute la ville. Et c’est à ce moment que des phénomènes surprenants commencent à se manifester.
« — Là, j’ai été témoin d’une altercation telle que… monsieur le bourgmestre, on a parlé politique!
— Politique! répéta Van Tricasse en hérissant sa perruque.
— Politique! reprit le commissaire Passauf, ce qui ne s’était pas fait depuis cent ans peut-être à Quiquendone. »
Lentement mais sûrement, les esprits se sont enflammés:
« Mais, phénomène absolument inexplicable, qui eût mis en défaut la sagacité des plus ingénieux physiologistes de l’époque, si les habitants de Quiquendone ne se modifiaient point dans la vie privée, ils se métamorphosaient visiblement, au contraire, dans la vie commune, à propos de ces relations d’individu à individu qu’elle provoque. (…)
« À la bourse, à l’hôtel de ville, à l’amphithéâtre de l’Académie, aux séances du conseil comme aux réunions des savants, une sorte de revivification se produisait, une surexcitation singulière s’emparait bientôt des assistants. Au bout d’une heure, les rapports étaient déjà aigres. Après deux heures, la discussion dégénérait en dispute. (…)
« Mais que se passe-t-il donc? se demandait [le bourgmestre]. Quel esprit de vertige s’est emparé de ma paisible ville de Quiquendone ? Est-ce que nous allons devenir fous? »
Ce n’était évidemment pas que pour le pire. Ce sursaut d’énergie avait aussi des avantages:
« Des talents, qui seraient restés ignorés, sortirent de la foule. Des aptitudes se révélèrent. Des artistes, jusque-là médiocres, se montrèrent sous un jour nouveau. Des hommes apparurent dans la politique aussi bien que dans les lettres. Des orateurs se formèrent aux discussions les plus ardues, et sur toutes les questions ils enflammèrent un auditoire parfaitement disposé d’ailleurs à l’inflammation. Des séances du conseil, le mouvement passa dans les réunions publiques, et un club se fonda à Quiquendone, pendant que vingt journaux, Le Guetteur de Quiquendone, L’Impartial de Quiquendone, Le Radical de Quiquendone, L’Outrancier de Quiquendone, écrits avec rage, soulevaient les questions sociales les plus graves. »
Même la nature s’en trouvait apparement transformée:
« En effet, dans les jardins, dans les potagers, dans les vergers, se manifestaient des symptômes extrêmement curieux. Les plantes grimpantes grimpaient avec plus d’audace.
Les fruits ne tardèrent pas à suivre l’exemple des légumes. Il fallut se mettre à deux pour manger une fraise et à quatre pour manger une poire. »
Tout dans la ville, habituellement si calme, s’accélérait follement.
Même les concerts, qui étaient traditionnellement exécutés plus lentement qu’ailleurs, se mirent à s’emballer. Un soir, un concert qui devait durer six heures ne dura que dix-huit minutes!
« Chanteurs et musiciens s’échappent fougueusement. Le chef d’orchestre ne songe plus à les retenir. D’ailleurs le public ne réclame pas, au contraire; on sent qu’il est entraîné lui-même, qu’il est dans le mouvement, et que ce mouvement répond aux aspirations de son âme (…) »
Sans trop qu’on sache pourquoi, toute cette énergie a même fait réapparaître une querelle vieille de plusieurs siècles avec le village voisin de Virgamen.
« [Il n’y avait aucune arme dans la ville], mais le courage, le bon droit, la haine de l’étranger, le désir de la vengeance [ont tenu] lieu d’engins plus perfectionnés et [pour] remplacer les mitrailleuses modernes et les canons (…) »
Le bourgmestre s’en est trouvé complètement désemparé.
« Mais qu’est-ce que nous avons ? Mais quel est ce feu qui nous dévore? Mais nous sommes donc possédés du diable? »
***
Mais qui était donc le mystérieux docteur Ox qui était à l’origine du projet d’éclairer la ville:
« Le docteur Ox était un homme demi-gros, de taille moyenne (…) Nous ne saurions préciser son âge, non plus que sa nationalité. D’ailleurs, peu importe. Il suffit qu’on sache bien que c’était un étrange personnage, au sang chaud et impétueux, véritable excentrique (…) Il avait en lui, en ses doctrines, une imperturbable confiance.
Toujours souriant, marchant tête haute, épaules dégagées, aisément, librement, regard assuré, larges narines bien ouvertes, vaste bouche qui humait l’air par grandes aspirations, sa personne plaisait à voir. II était vivant (…) bien allant, avec du vif-argent dans les veines et un cent d’aiguilles sous les pieds. Aussi ne pouvait-il jamais rester en place, et s’échappait-il en paroles précipitées et en gestes surabondants. »
Le docteur Ox était évidemment aussi très riche pour pouvoir entreprendre à ses frais l’éclairage de toute une ville.
Sauf que le projet d’éclairer la ville cachait sa véritable intention…
Le docteur Ox voulait en réalité faire la démonstration que l’esprit des Quiquendoniens peut être manipulé en dispersant un gaz dans la ville.
« Vous les avez vus, hier, à notre réception, ces bons Quiquendoniens à sang-froid? (…) Vous les avez vus, se disputant, se provoquant de la voix et du geste! Déjà métamorphosés moralement et physiquement! Et cela ne fait que commencer! Attendez-les au moment où nous les traiterons à haute dose ! (…)
N’avais-je pas raison? Voyez à quoi tiennent, non seulement les développements physiques de toute une nation, mais sa moralité, sa dignité, ses talents, son sens politique. Ce n’est qu’une question de molécules… (…)
L’expérience sera décisive (…) nous réformerons le monde! »
***
Je savais que Jules Verne avait été extraordinairement visionnaire au plan scientifique — avec De la Terre à la Lune et Autour de la Lune, notamment — mais à la lecture de ce petit livre, il me semble évident qu’il a également fait la démonstration d’une incroyable clairvoyance sociologique.
Cent cinquante ans plus tard, c’est Elon Musk qui revêt les habits du docteur Ox et c’est Twitter, devenu X, qui joue le rôle du gaz oxy-hydrique. Ni plus, ni moins.
Et pour conclure ce compte-rendu de lecture, je laisserai, comme il se doit, le mot de la fin à l’auteur:
« On a le droit de ne pas admettre la théorie du docteur Ox, et pour notre compte nous la repoussons à tous les points de vue, malgré la fantaisiste expérimentation dont fut le théâtre l’honorable ville de Quiquendone. »
C’était en 1872.