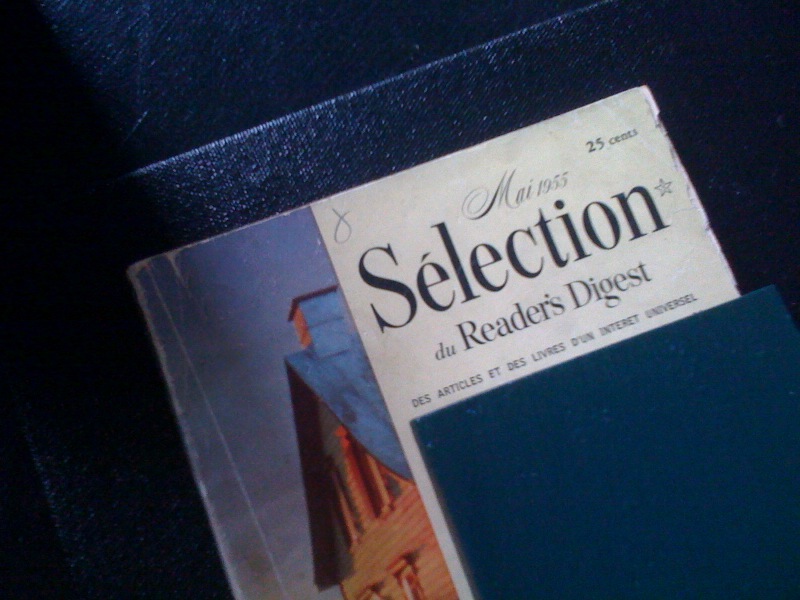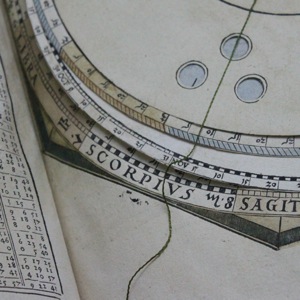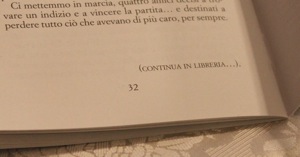Pour préparer la réunion de mon conseil d’administration virtuel, j’ai entrepris de relire Les années qui viennent, un livre qui a été publié par les Éditions du Boréal en 1987 et qui regroupe des chroniques que Jean-Paul L’Allier avait écrites pour Le Devoir au cours des années précédentes.
Plusieurs des chroniques sont d’une étonnante actualité.
Je reprends ci-dessous de larges extraits d’une de ces chroniques, parce qu’elle me semble apporter une réponse intéressante à la question que Stéphane Baillargeon pose à la une du Devoir de ce matin dans Pro bono publico:
À l’ère des mégaspectacles, des festivals et des superproductions, la culture est-elle condamnée à se justifier par le discours économique?
Elle me semble ajouter aussi une perspective historique importante au texte que Marie-Andrée Chouinard consacrait hier à la place de la langue française dans le Festival d’été de Québec.
* * *
Culture à la carte
Durant toutes ses années de vie politique, l’ex-maire de Montréal aura été, avant tout, un homme fasciné par les grands événements, les super-spectacles, les projets ayant un commencement, une apothéose et, pour la plupart, qu’il le veuille ou non, une fin. (…)
Les coûts de touts ordres n’ont que peu d’importance pourvu que le spectacle soit eau, si les gens l’aiment et si, de jeux en événements, on crée des images, des présomptions que l’on prend ensuite pour des certitudes.
Précurseur et intuitif, il se voit aujourd’hui confirmé dans ses choix par les élus de beaucoup de villes de tous les pays qui réagissent ainsi aux réflexes télévisuels des citoyens-spectateurs-consommateurs. D’autant plus que s’ils sont bien organisés et bien montés, on peut toujours prétendre que ces événements s’autofinancent par le décompte de toutes les retombées économiques et de toutes les taxes qu’ils génèrent et qu’ils apportent.
C’est la culture à la carte, un magazine vivant et, toutes dimensions de la culture déjà faite, une sorte de fantastique « Reader’s Digest » de l’Art.
Pour avoir l’impact souhaité et ne pas devenir le gouffre financier dont tous ceux qui se pressent pour l’inaugurer s’éloignent comme la peste au fur et à mesure de l’impression d’échec, l’événement doit être spectaculaire, original, grandiose et, à priori, populaire. (…)
Il ne s’agit pas, bien sûr, d’opposer d’une part la culture mondiale dans ses pointes d’excellence et dans ce qu’elle peut avoir produit de mieux, et d’autre part, les prétentions que l’on pourrait avoir ici, à partir de faibles ressources, de nos petites institutions et d’une population aussi restreinte, d’atteindre les mêmes sommets.
Ce qu’il faut retenir de cette culture à la carte, que l’on cherche de plus en plus à offrir puisqu’elle correspond à une formule gagnante, aux habitudes et aux goûts de la population, c’est que seule l’excellence des contenus, de la programmation, de la présentation, du marketing et de l’accueil sont des gages du succès.
Le Québécois consommateur de culture s’habituera vite à avoir accès à ce qui se fait de mieux et il est prévoir que les exigences monteront de plusieurs crans au cours des années à venir.
(…) la masse des consommateurs tendra plutôt à s’accroître, l’éducation culturelle n’en sera certes pas la cause puisqu’elle est virtuellement inexistante. C’est l’événement lui-même qui prime.
Dans ce contexte, il est à craindre que les gouvernements, toujours sensibles aux mouvements de l’opinion publique et aux modes autant qu’aux tendances nouvelles, cherchent maintenant à concentrer leurs interventions et les orientations de leur planification, lorsqu’elles existent, autour de l’événement. Quelle aubaine: il a des retombées positives sur le plan culturel, il en met plein la vue et peut même ne coûter à peu près rien à ceux qui, plastron en avant, l’inaugurent en propriétaire en notre nom à tous.
Leurs interlocuteurs ne seront donc plus d’abord les créateurs, les artistes et ceux que l’on a traditionnellement appelés « gens de culture » mais les promoteurs, concepteurs et vendeurs d’événements. (…)
Comment faire en sorte que ces « happenings » de la culture soient autre chose que des feux d’artifice et contribuent à consolider chez noues bases de toute première qualité en matière d’innovation et de création culturelle? Comment en assurer le suivi autrement que de fête en fête?
Comment faire pour que ces blocs de culture qui nous viendront presque toujours d’ailleurs, à de rares exceptions près (…) soient une formidable occasion d’éveil, de recherche d’excellence et de dépassement non seulement pour le monde de la culture, mais pour ceux qui ont la responsabilité de l’éducation à la culture, de l’organisation de la vie ou de la gestion des ressources gouvernementales?
Ne gâchons pas la fête. (…) Tant mieux si cela ne doit pas se faire au détriment de nos propres foyers de création et de nos institutions déjà souvent en retard.
Montréal a déjà fait la preuve qu’elle pouvait être un foyer original d’accueil et de diffusion extrêmement séduisante pour toute l’Amérique du Nord. À moins qu’il ne réussisse parallèlement et rapidement à démontrer qu’il peut aussi être un foyer de création et d’excellence tout aussi important pour les gens d’ici dans leur recherche de création et de dépassement, avec tous les coûts que cela suppose, toute la patience, toute la compréhension et toute la tolérance des femmes et des hommes publics, nous n’aurons fait que bouger sur place sans avancer, bien au contraire.
Pour un peuple comme pour les individus, c’est là toute la différence que de pouvoir écrire « la culture » en deux mots ou « l’aculture » en un seul ot. Le mot n’est peut-être pas encore au dictionnaire, mais la réalité l’emporte maintenant sur l’imaginaire.

 Je lis depuis quelques jours (sur mon iPhone, lors de mes déplacements et dans les transports en commun)
Je lis depuis quelques jours (sur mon iPhone, lors de mes déplacements et dans les transports en commun) 
 * Mon vieux et moi, de Pierre Gagnon, publié chez Autrement. J’ai adoré ce court roman: beau, triste et drôle à la fois. Un véritable coup de coeur. Pour le découvrir,
* Mon vieux et moi, de Pierre Gagnon, publié chez Autrement. J’ai adoré ce court roman: beau, triste et drôle à la fois. Un véritable coup de coeur. Pour le découvrir,  La chronique de Nicolas Dickner dans le Voir de cette semaine me plaît beaucoup:
La chronique de Nicolas Dickner dans le Voir de cette semaine me plaît beaucoup: