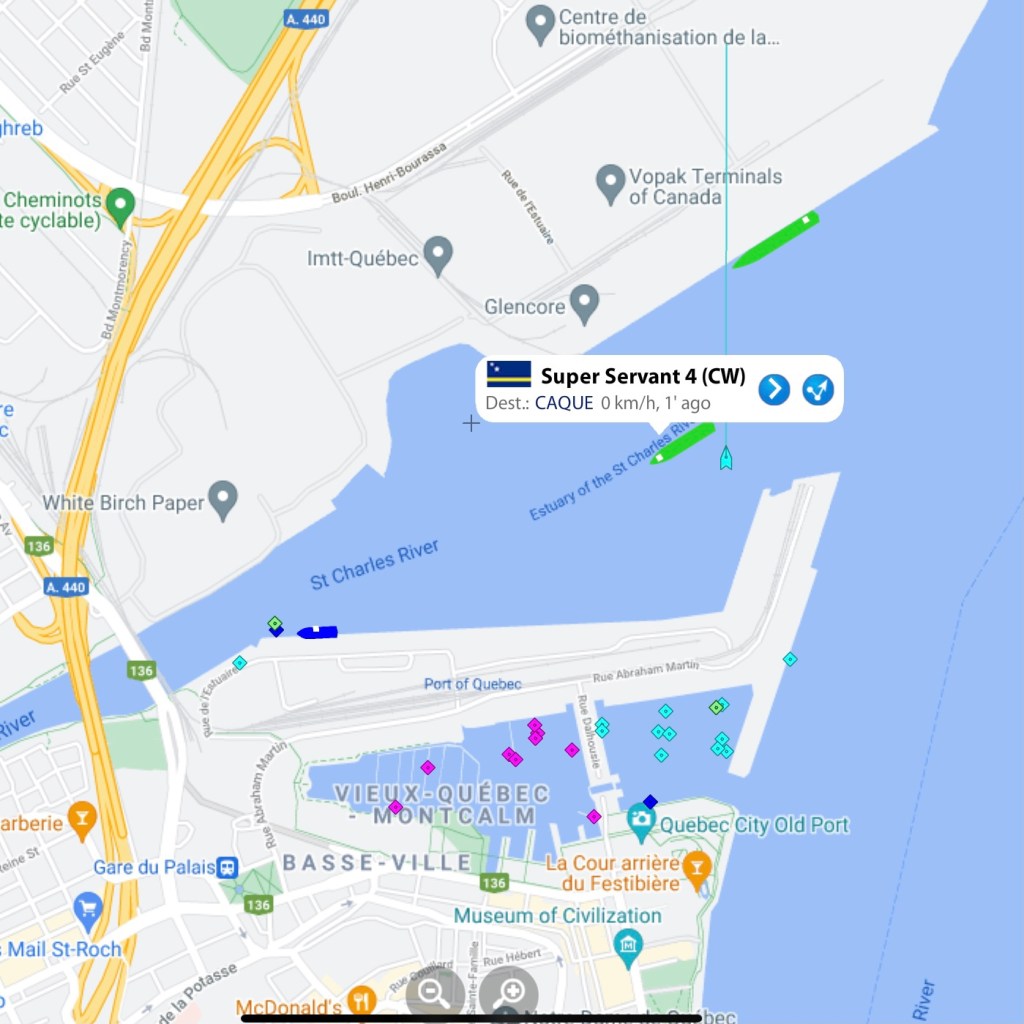J’ai accepté d’animer dans les prochains jours le Rendez-vous France-Québec sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones, qui a lieu cette semaine dans le cadre de MTL Connecte.
- Quatre conférences;
- Huit tables rondes;
- Vingt quatre intervenants;
- Et quatre périodes d’échange et de réseautage avec le public.
Ça promet! — et tout ça est gratuit, il n’y a qu’à s’inscrire.
Le Rendez-vous est organisé dans le cadre la stratégie commune du Québec et de la France pour favoriser la découvrabilité des contenus culturels francophones.
J’espère que nous aurons l’occasion de faire émerger des exemples inspirants de tout et même d’identifier quelques nouvelles pistes à suivre. Les séances préparatoires me rendent très optimiste.
Ci-dessous, quelques informations additionnelles sur la programmation.
***
MTL Connecte lance la toute première édition des Rendez-vous France-Québec sur la découvrabilité.
Quatre journées thématiques regroupant des acteurs culturels et du monde de la recherche québécois et français.
L’objectif est de créer un cadre d’échanges professionnels permettant la réflexion autour de problématiques communes, le partage de bonnes pratiques, et la présentation de projets innovants entre des acteurs culturels français et québécois.
MARDI 12 octobre — La découvrabilité au cœur de la transformation des organisations culturelles
- Conférencier: Jean-Gabriel Minel, du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance de France
- Panel 1: Joindre son public via des outils adaptés, avec Patrick Kearney (Le REFRAIN), Thibault d’Orso (Spideo) et Martin Bilodeau (Mediafilm)
- Panel 2: Le marketing numérique, le référencement, l’exploitation des données : des outils indispensables pour la découvrabilité des contenus, avec Isa Mailloux (Musée de la Civilisation) Catherine Gentilcore (Opéra de Montréal) et Vincent Castaignet (Musicovery).
MERCREDI 13 octobre — Se démarquer sur les marchés étrangers par une meilleure découvrabilité des contenus francophones
- Conférenciers: Hélène Zemmour, de TV5MONDE et Benoit Beaudoin, de TV5 Québec Canada
- Panel 1: Bien se positionner sur les marchés étrangers grâce à l’analyse de données d’usage, avec Jacynthe Plamondon-Emond (InTempo/Amplitude Distribution), Quentin Deleau (Unifrance) et Edouard Reinach (Adviso).
- Panel 2: S’adapter aux spécificités territoriales : quelles barrières et quels outils?, avec Jean-Christophe J. Lamontagne (h264), Gilles Freissinier (Arte) et Sylvia Cibien (Eurovod).
JEUDI 14 octobre — La métadonnée sans frontières
- Conférencier: Christian Roy, de A10s
- Panel 1: L’exploitation des métadonnées au service de meilleures interopérabilité et structuration de l’organisation, avec Pascal Dumont-Julien (MétaMusique), Isabelle Reusa (Videomuseum) et Frédérique Joannic-Seta (Bibliothèque Nationale de France).
- Panel 2: Les métadonnées au service d’une meilleure visibilité des contenus et d’une plus grande reconnaissance des artistes, avec Frédérique Dubé (Productions Rhizome), Louise Brunet (Culture Laval) et Eudes Peyre (Réunion des Opéras de France).
VENDREDI 15 octobre — Les défis à venir pour la découvrabilité en ligne des contenus francophones
- Conférencière: Catalina Briceno, de l’Université du Québec à Montréal
- Panel 1: Mesurer la découvrabilité, entre théorie et pratique, avec Joëlle Farchy (Université France Paris 1), Jean-Robert Bisaillon (Iconoclaste musique) et Benoit Beaudoin (TV5 Québec Canada)
- Panel 2: L’innovation au service de la découvrabilité des contenus francophones, avec Destiny Tchéhouali (Université du Québec à Montréal), JB Piacentino (Edtech One) et Loic de Visscher (RTBF).
Pour s’inscrire et pour l’horaire précis des événements, c’est ici.