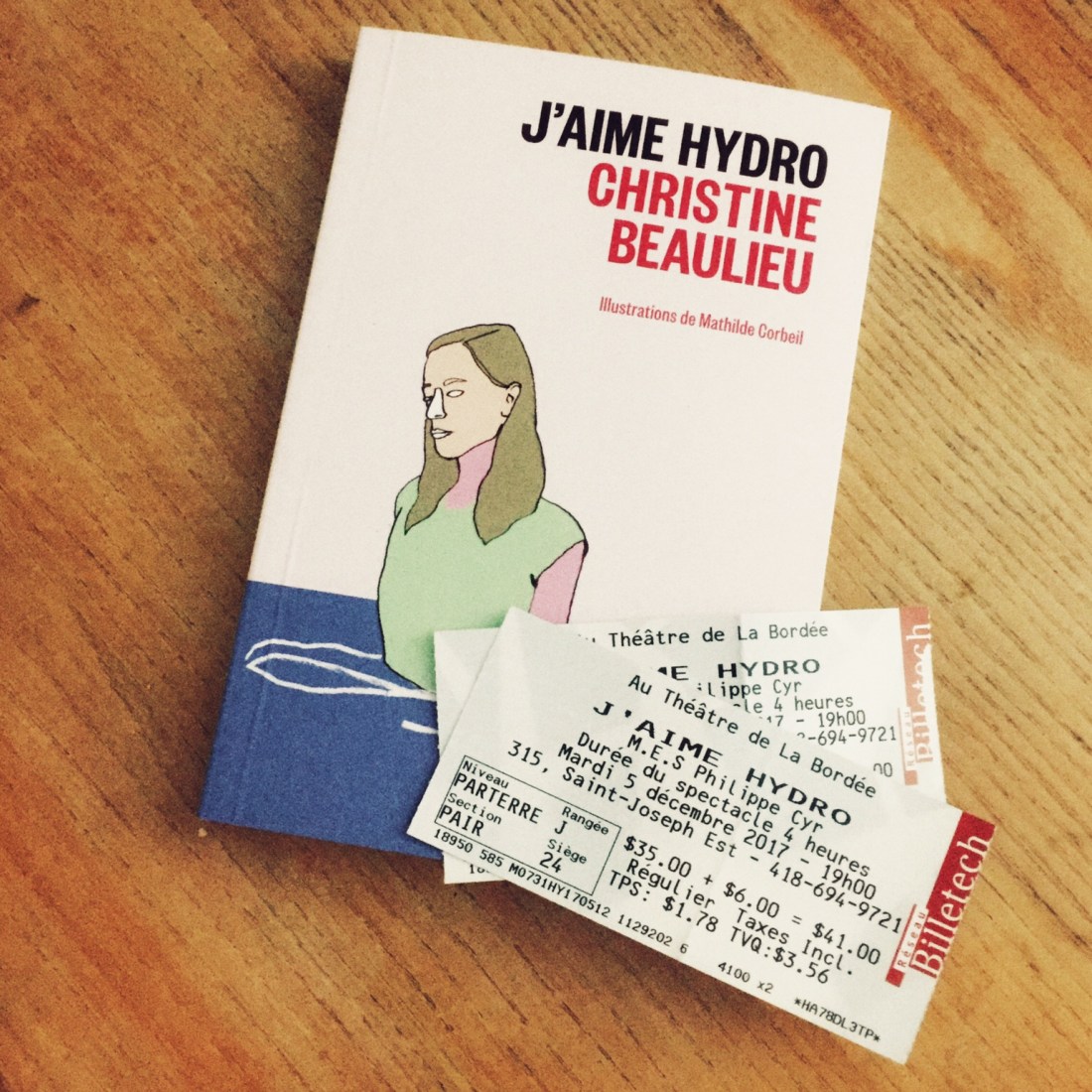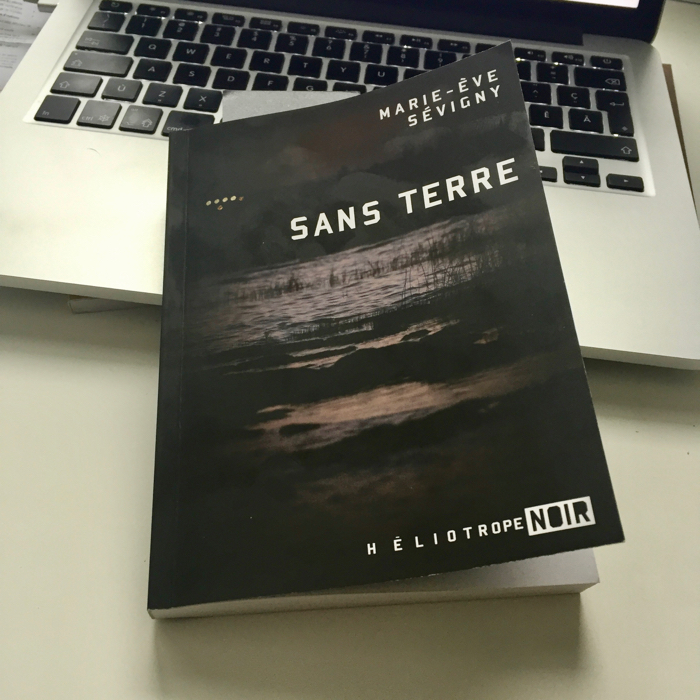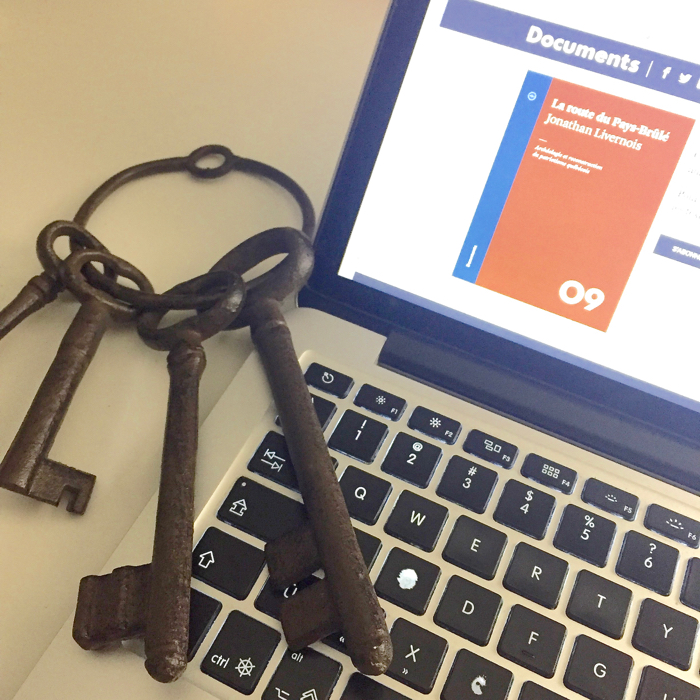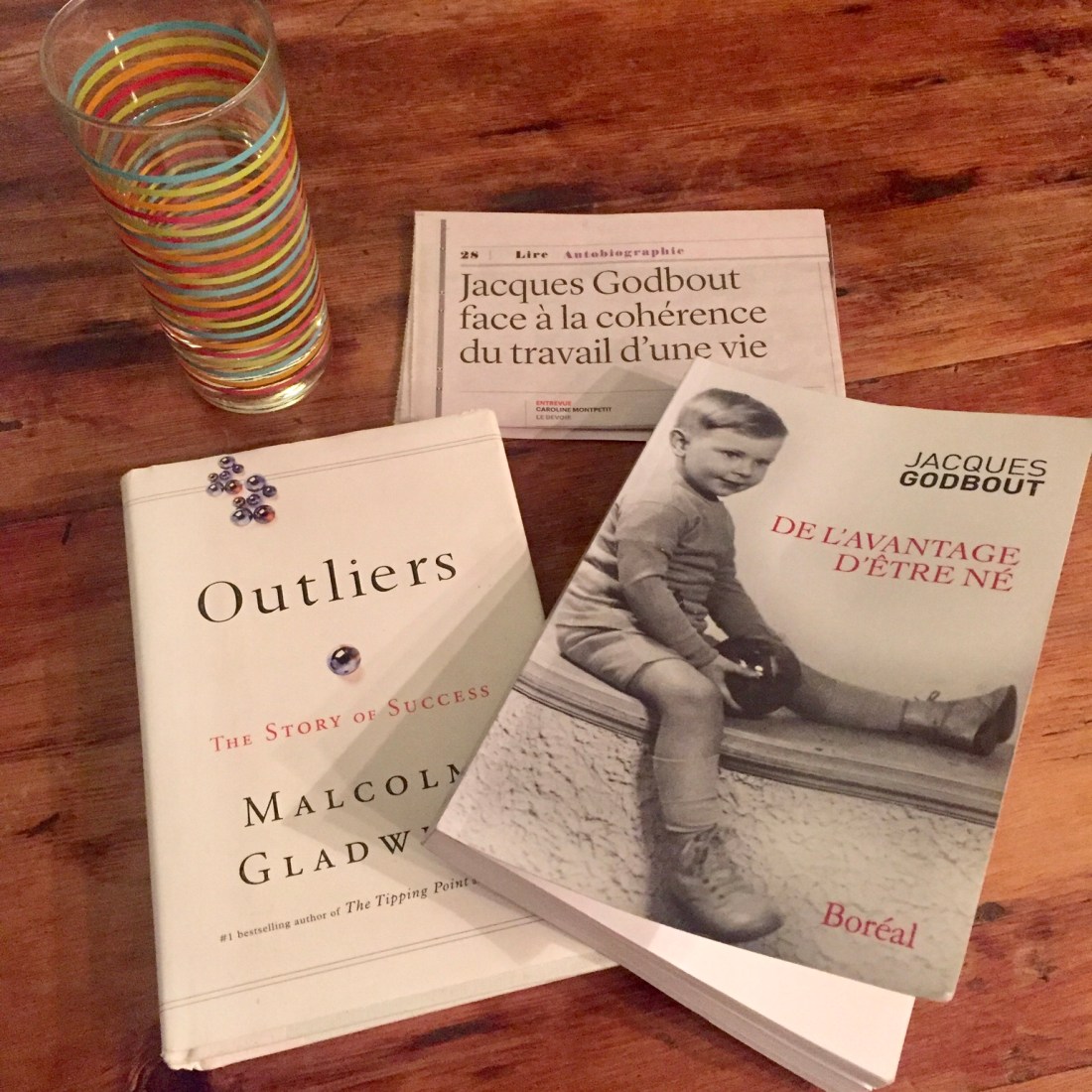
Il y a dix ans, j’ai été marqué par la lecture de Outliers — de Story of Success, de Malcom Gladwell.
Gladwell explique dans ce livre que les raisons habituellement données pour expliquer le succès exceptionnel de certaines personnes sont trompeuses. Selon lui, les avantages qu’un contexte très particulier a pu procurer à ces personnes expliquent souvent beaucoup mieux leur succès que des talents innés.
« In Outliers, I want to convince you that these kind of personal explanations of success don’t work. People don’t rise from nothing. (…) in fact they are invariably the beneficiaries of hidden advantages and extraordinary opportunities and culturels legacies that allow them to work hard and make sens of the world in ways others cannot.»
L’auteur donne notamment l’exemple du hockey, dont les meilleurs joueurs sont, dans une proportion anormale, nés dans les deux ou trois mêmes mois de l’année. Évidemment parce que le processus de sélection avantagent indûment les enfants nés à cette période de l’année… un avantage qui se répète tous les ans pendant toute leur formation. C’est un peu la même chose avec l’école, d’ailleurs, ajoute-t-il.
De la même façon, plusieurs des créateurs des plus grandes entreprises informatiques actuelles sont nés autour de 1955: Bill Gates et Paul Allen, pour Microsoft, le regretté Steve Jobs, pour Apple, et Eric Schmidt, pour Novell et Google, par exemple.
Pourquoi sont-ils milliardaires aujourd’hui? Parce qu’ils ont eu la chance d’être ados quand l’ordinateur est devenu accessible et que leurs conditions familiales leur ont permis d’y avoir accès rapidement. Ils étaient juste assez âgés pour pouvoir y passer des dizaines d’heures chaque semaine, et pas assez pour avoir déjà des obligations, familiales ou professionnelles, contraignantes. Ils ont évidemment quand même le mérite d’avoir su profiter de cet avantage, mais sans celui-ci, malgré leurs talents, il en aurait sans doute été autrement.
Cela n’empêche donc absolument pas de s’émerveiller du parcours et des réalisations de ces personnes, cela nous invite seulement à les apprécier différemment. Avec une perspective un peu plus sociologique.
Je me souviens qu’il y a dix ans, la lecture d’Outliers m’avais plongé dans une intense réflexion sur les conditions dans lesquelles j’ai grandies — et sur les conditions dans lesquelles je vivais / je vis.
***
Ce sont ces réflexions qui me sont revenus à l’esprit au cours des derniers jours en lisant De l’avantage d’être né, de Jacques Godbout. Le Devoir en faisait d’ailleurs une bonne description samedi.
L’auteur trace dans ce livre le récit anecdotique de sa vie («un inventaire systématique de ma vie publique»), au cours duquel on voit littéralement le Québec se transformer d’une année à l’autre (généralement pour le mieux).
La première chose qui m’a frappé au cours de la lecture, c’est la très grande proximité des acteurs de cette transformation. Dans cette version de l’histoire, tout semble possible au Québec. Il s’agit s’asseoir les bonnes personnes autour de la table, d’ouvrir une bouteille de vin, de proposer une idée… et d’oser la réaliser.
L’ouverture (mieux: l’accueil) que fait l’Europe aux Québécois est aussi étonnante. La possibilité, nouvelle, pour ces quelques inventeur du Québec d’aller y chercher fréquemment inspiration, réseaux de contacts et d’influence et essentielle au parcours de l’auteur.
J’avais ressentis un peu même chose lors d’un déjeuner avec Claude Morin et Pascal Assathiany il y a quelques années: le Québec moderne s’est bâti dans un cadre beaucoup plus souple/simple qu’il ne l’est aujourd’hui — où les relations amicales et les complicités intellectuelles étaient probablement bien plus déterminantes qu’elles ne le sont aujourd’hui. Pour le meilleur et pour le pire.
La conclusion de son livre démontre avec éloquence que Jacques Godbout est très conscient de la chance que le lieu et le moment de sa naissance lui a offert pour exprimer ses talents.
***
J’ai beaucoup apprécié la lecture de De l’avantage d’être né — même si je suis un peu resté sur ma faim au moment de tourner la dernière page.
J’aurais aimé que Jacques Godbout ajoute un chapitre pour élaborer un peu sur l’interprétation qu’il fait du contexte actuel en comparaison de celui dont il a eu la chance de profiter.
Concrètement, le dernier chapitre du livre s’intitule de l’avantage des octogénaires. J’aurais aimé en avoir un autre pour lire ses réflexions au sujet de l’avantage des quadragénaires (à tout hasard!) en 2018.
Peut-être faudra-il que l’écrive moi-même ce chapitre finalement.