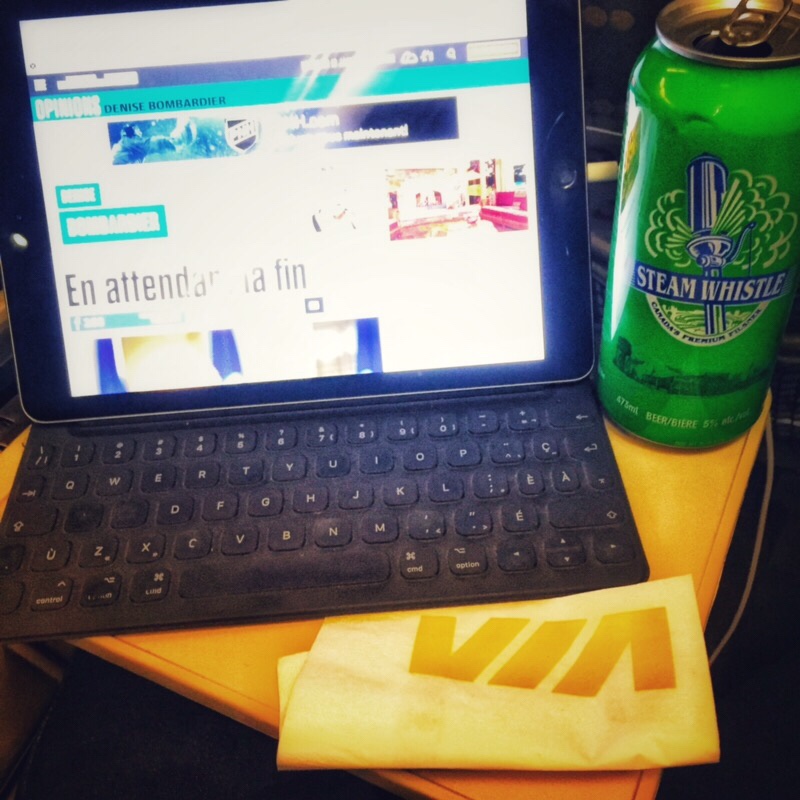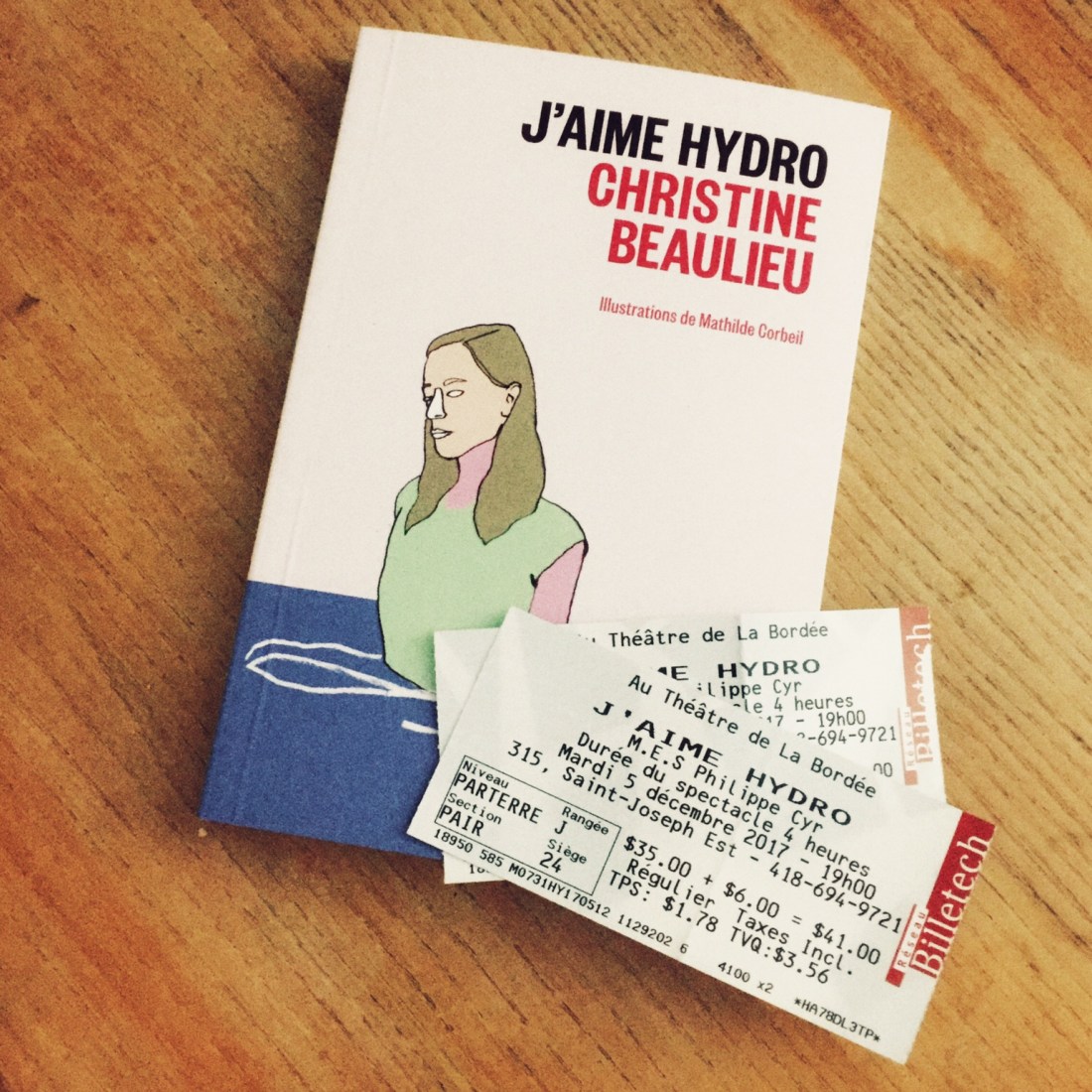Il y a quelques jours Marc Saint-Pierre m’a interpellé sur Facebook pour savoir ce que je pensais du texte de Naja Vallaud-Belkacem, Éloge de l’imperfection en politique, qui a été publié dans le Nouveau Magazine Littéraire du 17 décembre 2017.
Il me suggérait d’en faire une lecture québécoise en remplaçant les références au Parti socialiste par des références au Parti québécois; de même pour Mitterand, avec René Lévesque, par exemple.
Matière à réflexion, disait-il. Je préfèrerais personnellement en faire un appel à l’action. On a la chance de s’interroger ici sur tout ça neuf mois avant l’élection plutôt qu’au lendemain d’une défaite. Il faudrait en profiter. Et je suis sûr qu’on en a la capacité — si on s’y met. Rapidement.
Je vous invite donc à mon tour à lire le texte de l’ancienne ministre de l’Éducation nationale, idéalement dans sa version complète, même si j’en ai préparé une version courte en sélectionnant quelques extraits.
***
Éloge de l’imperfection en politique
Par Najat Vallaud-Belkacem
Contre les vents d’une époque que l’on dit promise [à la droite] je le confesse volontiers : je suis, je reste sociale-démocrate. […] Les commentateurs la proclament morte ? Je veux la faire vivre.
Certes, je ne suis pas aveugle. […] Je cerne nos erreurs, nos divisions, nos renoncements. En silence jusque-là. Notre débâcle n’est pas qu’une affaire de pédagogie ratée ou de communication mal gérée. Elle ne s’explique pas non plus par la force des réseaux conservateurs. Elle a des causes plus profondes. Le divorce entre une large majorité de nos concitoyens et la gauche dans laquelle je me reconnais est indéniable.
Nos idées sont devenues minoritaires, et il nous incombe à tous de chercher à comprendre pourquoi. De réfléchir. De sortir, donc, de la société du spectacle. Les innombrables batailles [que nous avons perdues] ont creusé une faille qu’aucune agence de communication, aucune synthèse interne et aucun plan média ne sauraient combler. Nous avons perdu la plupart de ces batailles faute de les avoir menées. Tout simplement. Nous nous sommes embourgeoisés. Endormis.
Qui donc est responsable de cette inversion des rapports de force culturels en France et ailleurs? Nous. À rester dans notre zone de confort intellectuel, à entonner sans cesse le refrain des certitudes, à préférer la rengaine des slogans à l’exigence de reformulation et à l’invention de nouveaux concepts, à préférer la com à la pensée tout simplement, nous avons nous-mêmes altéré l’éclat de nos idées, de nos mots, de nos principes. (…)
Ce n’est pas un cycle électoral de cinq, dix ou même vingt ans qui s’achève sous nos yeux, mais une ère idéologique et culturelle de près de cinquante ans (…) Si nous voulons donner une chance à la refondation en profondeur de la social-démocratie, et non pas simplement repousser l’échéance d’un terminus ultime d’un appareil partisan, ne nous laissons pas enfermer dans le confessionnal beaucoup trop étroit du quinquennat de François Hollande.
En 1971, François Mitterrand ouvrait un chemin nouveau en resserrant les rangs autour d’une ligne politique célèbre, celle de la rupture avec l’ordre établi. Celui qui ne consentait pas à cette ligne de rupture, disait-il, ne pouvait pas être adhérent du Parti socialiste. Plus jamais par la suite nous n’avons exprimé cette exigence de clarté et de radicalité dans ce que nous sommes, ce que nous défendons et ce que nous voulons, sans fléchir d’une manière ou d’une autre devant la puissance supposée de l’opinion dominante (…)
À nous aujourd’hui de redéfinir précisément ce avec quoi nous voulons rompre : la perspective d’un monde devenu inhabitable du fait d’un mode de croissance qui épuise les ressources de la planète et invivable du fait de l’explosion des injustices et des inégalités jusqu’à l’insoutenable. Le moment est venu de renouer avec ce geste politique, non pas en nous retournant sur nous mêmes ou en jouant aux gardiens de musée, mais en tendant la main à la génération qui vient, celle qui inventera le socialisme de demain. (…)
C’est ainsi que nous regagnerons ces batailles culturelles que nous avons perdues, et, au passage, c’est ainsi que nous préparerons l’avenir, car, à titre personnel, je n’ose imaginer un monde dans lequel, face aux grands défis qui s’annoncent autour de l’intelligence artificielle, de l’homme augmenté ou des sciences prédictives, les seules réponses politiques apportées seraient celles du tout-libéralisme, du tout-populisme ou encore du tout-« a-politisme » dans lequel l’opportunisme l’emporte sur le rêve d’une société émancipatrice. Plus juste. Plus solidaire.
***
D’un côté, c’est bon de constater que nos problèmes sont partagés — qu’il y a quelque chose d’un peu plus universel dans les difficultés que nous rencontrons actuellement.
D’un autre côté, ça ne fait qu’accroître l’importance d’arriver à s’en sortir. Et à faire ce qu’il faut pour y arriver… parce que je suis sûr qu’on peut y arriver!
Alors qu’est-ce que ça signifie pour nous, ici, au Québec, en janvier 2018?
—
Mise à jour: On peut évidemment aussi lire ce texte en parallèle avec cet autre texte, publié hier dans Le Devoir: Penser la gauche autrement.