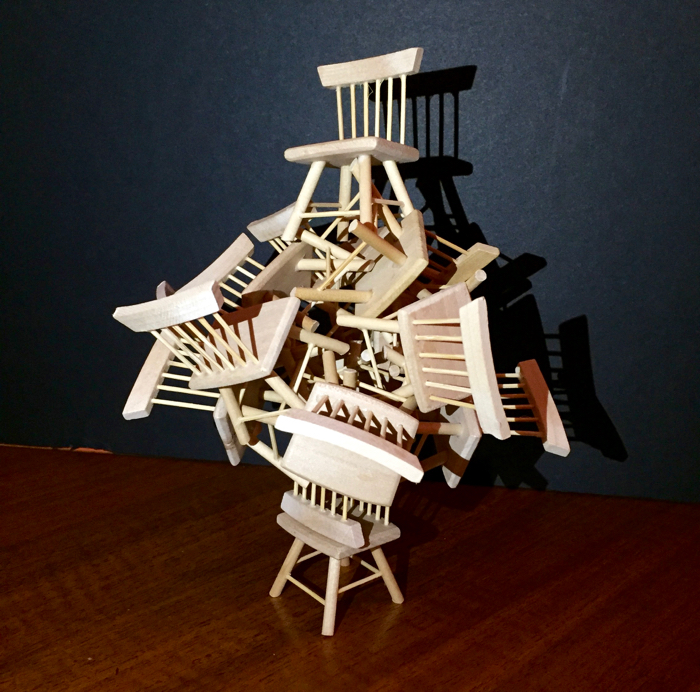L’auteur Yvon Rivard publiait une lettre coup de poing dans Le Devoir du 10 juin.
« Ce matin, je ne perçois plus que la face sombre du destin québécois (…) Je ne vois plus qu’un pays qui s’enlise dans l’insignifiance et l’incohérence…»
«La question que je me pose depuis des années et qui resurgit violemment ce matin est la suivante: comment se fait-il que le Québec des cinquante dernières années ait développé tant de compétences dans tous les domaines (artistiques, intellectuels, économiques, etc.), ait favorisé l’émergence d’une véritable conscience sociale, écologique, féministe, et que tout cela aboutisse à tant de médiocrité politique et morale?»
Le jugement est très dur. Mais je dois admettre qu’il me rejoint, moi, l’optimiste. Et ça fait mal. Ça me rappelle un peu Le Québec me tue d’Hélène Jutras, en 1994.
Mais comment reprocher à Yvon Rivard ce sentiment quand on voit l’actualité des dernières semaines? Pire: quand on constate l’outrecuidance du premier ministre, chef du Parti Libéral, qui s’entête à vouloir nous convaincre que ça ne va pas si mal. Et même que ça va bien.
C’est complètement ridicule, et c’est la cerise sur le sundae du désastre, mais ce n’est malheureusement pas tout.
Il y a aussi une forme de négligence de tous les autres partis politiques, qui contribuent à cette ambiance en s’enlisant, jour après jour, dans des jeux partisans qui ont maintes fois démontré leur insignifiance — et qui, dans les faits, ne font qu’entretenir le statu quo.
Quand je lis dans un article placé à la une du Devoir que «la campagne d’idées de Jean-François Lisée vient brouiller les cartes [dans la course à la chefferie au Parti Québécois]», je me dis que ça résume admirablement le malaise dans lequel nous sommes plongés: le vide.
Nous sommes devant un dur constat: au Québec, les calculs partisans ont depuis trop longtemps pris le dessus sur les idéaux… dont le monde politique devrait pourtant être l’indispensable porteur. Et ce n’est certainement pas le seul fait du Parti Québécois. C’est toute notre vie démocratique qui sombre trop souvent dans la mise en scène.
Il m’apparaît important de rappeler, à cet égard, un passage du texte d’Hélène Jutras:
«Il y a, bien sûr, des gens de mon âge que la politique enthousiasme. Je ne les comprends pas. Sur le plan théorique, oui, la politique m’intéresse, mais dans la pratique, la campagne électorale me fait bâiller. J’aurais une idée pour améliorer le tout: j’interdirais à tous les candidats de parler de leur adversaire pour le critiquer. Ils ne parleraient plus du tout. Car, à quoi bon critiquer l’autre, quand on pourrait parler des idées qu’on défend plutôt que de celles qu’on désapprouve?»
C’est une remarque qui me semble tout aussi pertinente, sinon plus, vingt ans plus tard. Et ce n’est pas étranger au choix que je fais aujourd’hui de m’accrocher, de toutes mes forces, à la possibilité de faire la Politique autrement. Ça me semble nécessaire pour ne pas sombrer dans le cynisme, pour pouvoir continuer à militer, comme président du Parti Québécois pour la circonscription de Jean-Talon et pour la région de la Capitale-Nationale. Parce qu’il faut continuer. Parce que c’est plus indispensable que jamais.
Je suis convaincu que ce n’est pas en faisant seulement un peu mieux, et même de façon beaucoup plus charismatique, le même genre de politique que nous avons fait depuis quinze ans que nous arriverons à obtenir des résultats différents. Il faut absolument remettre très clairement de l’avant nos idéaux, proposer des idées qui sortent des sentiers battus et donner forme à des projets concrets. On doit réenchanter la politique.
C’est une nécessité si on veut intéresser à nouveau celles et ceux, jeunes et vieux, ici depuis toujours et arrivés depuis peu, qui se sont désintéressé de la politique au fil des ans, notamment — il faut bien l’admettre — devant l’entêtement du Parti Québécois à ressasser d’inutiles débats sur le meilleur moment pour tenir un troisième référendum (qui ne sera pourtant jamais plus qu’un moyen pour conclure une démarche de rassemblement national autour d’un projet de société particulièrement ambitieux).
Pour se sortir du bourbier collectif décrit par Yvon Rivard, il faut que nous trouvions les moyens pour redonner confiance aux citoyens dans le monde politique. Il faut leur redonner le goût de s’y intéresser, et éventuellement de s’y engager.
Sans ça, on risque fort de continuer à s’enliser dans l’insignifiance et l’incohérence.