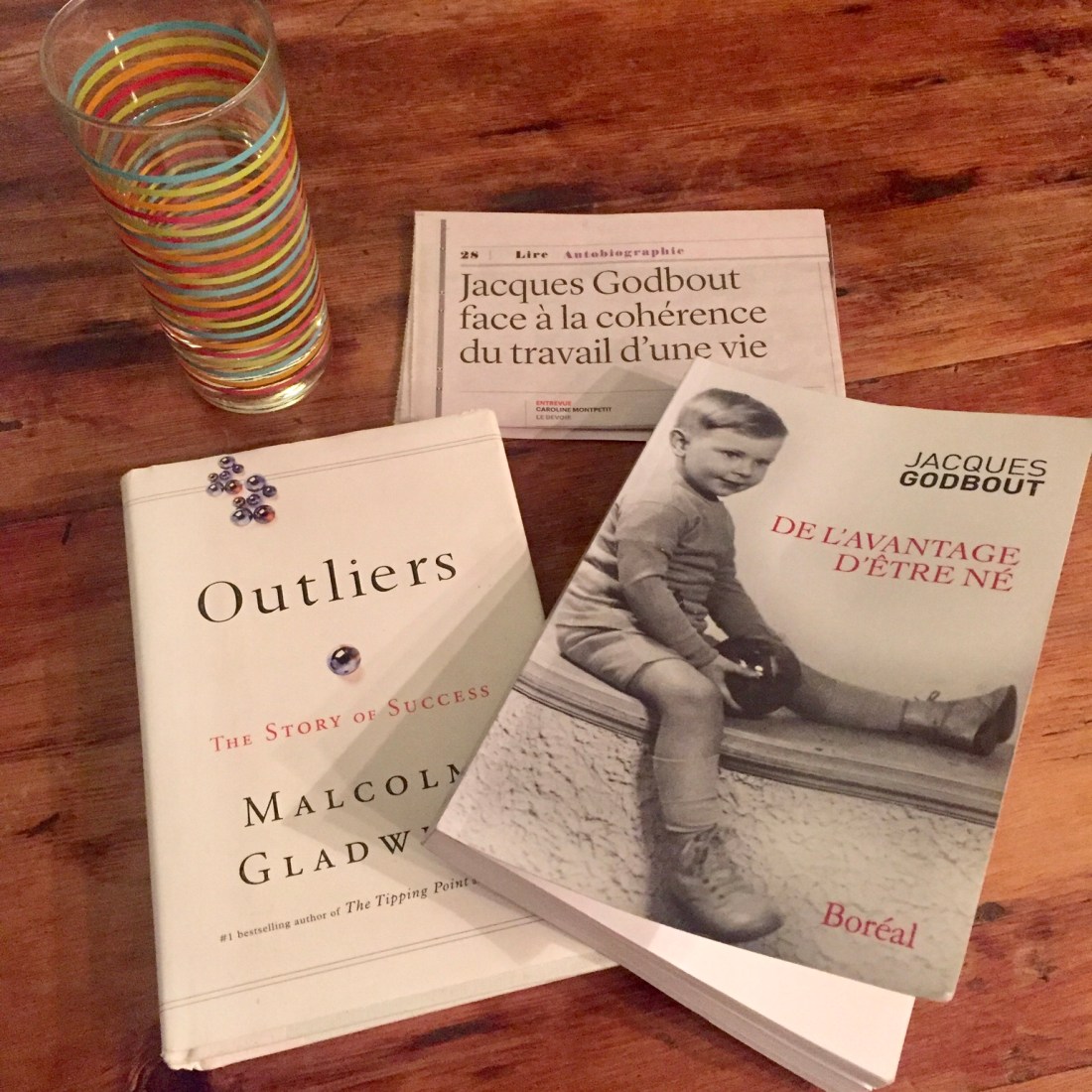J’ai publié ce matin un court texte pour partager mon appréciation de la chronique d’Odile Tremblay dans Le Devoir de ce matin. Ça n’a pas été très long avant que je reçoive de premières réactions — tant positives et négatives, en privé pour la plupart. Normal pour un sujet aussi controversé.
Cela a aussi donné l’occasion d’un échange avec mon beau-frère, René Audet, qui est professeur de littérature à l’Université Laval. J’en reprends ici l’essentiel, avec son autorisation.
Ça démarre sur un désaccord au sujet de la pertinence d’organiser des « États généraux de la culture » (suggestion formulée par Odile Tremblay, à laquelle je m’associe) et ça se termine (si un tel échange est jamais terminé !) sur une question reformulée… et une idée à laquelle il resterait à donner forme.
N’hésitez pas à commenter à votre tour !
***
René: « quartiers [états] généraux du monde culturel pour établir des balises de protection créatrice » : euh… pour laisser toute la place à la bien-pensance et à la rectitude, pour laver du linge (en partie) sale sur la place publique, peut-être. Mais ce genre de grand-messe pourra difficilement faire avancer les mœurs – ça sera plutôt un motif de jeter encore un peu plus d’huile sur le feu, de se limiter à la rhétorique de la faute antérieure irréparable. Il faut regarder par en avant, garder un regard ouvert sur les cohabitations culturelles, donner sa chance à chacun. Pas favoriser une attitude voulant policer les mœurs et les intentions… M’enfin, y’a de quoi s’y perdre.
Clément: Oh, la police des mœurs et des intentions : loin de moi cette idée. Mais est-ce que cette idée de temps d’arrêt collectif est contradictoire avec le vœu, que je partage, de « regarder en avant, garder un regard ouvert sur les cohabitations culturelles [et] donner sa chance à chacun » ? On serait condamné à une version cheap de la commission Bouchard-Taylor recevant la famille Pineault-Caron ? Je ne peux (veux) pas croire ça.
René: Les états généraux me font frémir. Parce qu’ils sont parfois noyautés par des visions politiques opportunistes, par des purs et durs qui veulent casser la baraque… et qu’ils rassemblent aussi des gens qui ne sont pas les premiers acteurs du domaine visé (parce que les acteurs sont plutôt sur le terrain, en train de bosser). On ne peut pas régler ce genre de trucs par une grand-messe, mais plutôt par du travail de terrain, sur le moyen terme, et peut-être aussi par des interventions solides de gens respectés qui pourront agir sur les modes de pensée. My 2¢…!
Clément: « Des interventions solides de gens respectés qui pourront agir sur les modes de pensée.» – bien sûr, c’est le meilleur scénario ! Mais où sont-ils ces gens ? Et quelles tribune auront-ils si on ne crée pas les conditions favorables à leur prise de parole ? Dans l’environnement médiatique actuel…
René: Peut-être, justement, ce n’est pas par les médias que ça doit passer, mais par de plus petites rencontres, loin des caméras. Je suis sûrement pessimiste et idéaliste sur ce coup. Mais je crois que l’affaire a beaucoup trop « bénéficié » du spin médiatique et que l’outil n’est pas approprié pour renverser la vapeur. Les acteurs du monde du théâtre s’en parleront intensément dans les prochains mois, les échos seront perceptibles dans le secteur du cinéma, de la télévision. Des gens poseront des questions, ne voudront pas être au centre d’une semblable polémique… Le travail se fera peu à peu dans les milieux, je crois.
Clément: Trop de spin médiatique : *assurément*. Mais à mon avis la question est maintenant plutôt de savoir si on peut faire la suite « à l’abri de la réalité médiatique », ou si on doit trouver moyen « de faire avec ».
René: Ou, plus précisément : si le monde médiatique est partie prenante de la suite ou simplement une instance de relais. Ça me semble assez différent. L’option 2 est peut-être illusoire (au sens où les médias sont de plus en plus interventionnistes), mais il est possible que le scénario vise d’abord à impliquer les gens concernés et que le spin médiatique vienne en appui, dans un deuxième temps…
Clément: Cela dit, je suis d’accord avec toi que la forme d’éventuels « états généraux » devrait aussi faire l’objet d’une réflexion approfondie. Ce ne peut pas être qu’une grande messe de quelques jours. Ce serait jouer le jeu des médias plutôt que de faire avec lui. Pensons à un événement plus participatif, plus sur le modèle de la co-construction que d’une série de dépositions devant un tribunal ou une commission d’enquête ; quelque chose qui se réalise sur une ou deux années plutôt que sur quelques semaines ou mois – avec des interventions réelles dans les milieux, entre des étapes un peu plus exposées publiquement/médiatiquement… Soyons ingénieux !
René: Ouep, en effet. Ça correspond davantage à mon idée de travail sur le terrain. Ceci dit, le succès réside dans la légitimité de l’instance qui prendra l’initiative (et la parole) – plusieurs instances se sont mouillées, avec une réaction plus ou moins consensuelle, alors que d’autres brillent par leur absence/silence. Qui pourra être bien perçu dans le comité d’organisation d’un tel projet ?
Clément: Pourquoi pas des « états généraux » dans le cadre desquels on demanderait aux musées (et aux musées nationaux, en particulier), aux bibliothèques (et à BAnQ, en particulier), ainsi qu’aux établissements scolaires, cégeps et universités, de participer ? Une démarche où les milieux de travail (publics et privés) auraient aussi la possibilité de se raccrocher ? Pourquoi pas une démarche très décentralisée, donc, qui serait aussi plus susceptible de rendre compte de la diversité des points de vue et des réalités régionales ? Tout cela pourrait par la suite être « ramassé » à l’occasion d’un événement-synthèse destiné à dégager des consensus (parce que oui, je crois toujours à l’importance des consensus, plus que jamais même).
René: Dans l’absolu oui, pourquoi pas. Mais quel serait le pitch, quelle serait la commande ? (de façon à ne pas seulement enfoncer le clou de l’auto-flagellation) Plutôt centrer la démarche autour de projets ou initiatives qui illustreraient là vers où on veut aller, et non centrer sur les travers à éviter ? Une définition de la culture commune/partagée ? Ça finira par être un projet de pays :)
Clément: Me voilà démasqué !
René: Cela dit, la question qui me paraît fondamentale est : quelle est la commande, l’orientation du truc ? Trop facile de se limiter à la seule rhétorique de la réconciliation (avec un arrière-plan de contrition piteuse), alors qu’on peut plutôt/aussi se demander comment on peut faire à l’avenir, tous ensemble.
Clément: Je suis d’accord, le mandat confié aux responsables de ce genre d’États généraux est déterminant. Une discussion à son sujet (forcément très politique – d’où le besoin d’un leadership dont on est toujours à la recherche !) est un passage obligé avant d’aller plus loin, à défaut de quoi je te concède qu’on en restera très probablement aux vœux pieux.
Dialoguer c’est bien. Développer des pratiques culturelles (et éducatives !) communes, partagées, c’est encore mieux !
—
Image: Vaduz (fragment), 1974, Bernard Heidsieck. Vu au Centre Georges-Pompidou en août 2017.